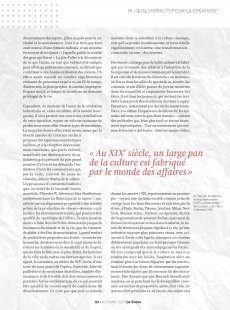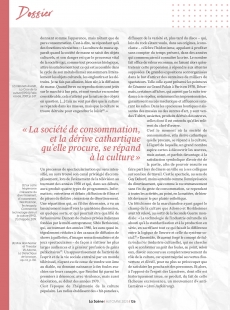« Les IA génératives ou la (nouvelle) crise de la culture »
Bonnes feuilles du Désert de nous-mêmes d'Éric Sadin publiées dans La Scène.
Ce texte est issu de l’ouvrage Le Désert de nous-mêmes. Le tournant intellectuel et créatif de l’intelligence artificielle (L’Échappée, parution le 3 octobre).
L ivres de littérature classique ou actuelle, de dark romance ou d’heroic fantasy ; expositions d’art historique, moderne, contemporain, de photoreportages ou de photographies amateurs ; fréquentation de lieux de spectacles pour y voir du théâtre de répertoire, de recherche, de boulevard, des pièces de danse, des comédies musicales, ou du stand-up ; visionnage de films ou de séries ; écoute de morceaux musicaux de tous genres ; défilés de collections de haute couture, reconstitutions d’événements passés, festivals folkloriques ou de gastronomie régionale… Depuis plus d’un siècle, est placé dans le champ de la culture un registre régulièrement étendu de pratiques, alors que celles-ci semblent de moins en moins regrouper de dénominateurs communs. Soit un oubli progressif, et fort éloquent, de son sens propre qui, avant tout, renvoie à une vision de l’existence. Car ce qui la caractérise – rappelant en cela le devoir d’établir de bonnes classifications afin de ne pas omettre le caractère spécifique de certaines dimensions de la vie humaine et la contribution unique qu’elles peuvent offrir – c’est qu’elle apporte une richesse à nulle autre pareille. Dans la mesure où elle constitue un vecteur d’élévation de l’âme. Du fait de la rencontre avec autrui, en tant que figure entendant témoigner sans limites de sa singularité, formalisée dans ses œuvres, à même d’éveiller la sensibilité, d’animer l’activité de l’esprit, d’exposer des points de vue inédits, jusque parfois provoquer des chocs modifiant le cours de destins. À ce titre, le rapport à la culture présuppose toujours le risque, ou la joie, de faire l’épreuve d’un décentrement. C’est-à-dire d’un trouble vécu de nos schémas perceptifs et conceptuels.
En cela, se trouve partagée entre l’artiste et l’amateur une philosophie de l’existence ambitionnant de ne pas être trop contrainte à la normativité du quotidien, pour arpenter, au gré de ses envies et possibilités, des chemins de liberté et de découvertes insoupçonnées.
La convergence entre ces deux hautes et nobles aspirations éprouvées de part et d’autre a pour nom culture. C’est pour ces raisons que, dans l’histoire, d’abord des mécènes et, plus tard, des États, ont soutenu des créateurs et des institutions de diffusion des œuvres. Car la culture revêt une valeur sociale, du fait des multiples liens entre les êtres et, souvent, par-delà les âges, qu’elle instaure – mais aussi une valeur morale. Dans la mesure où elle procède de l’axiome selon lequel il existe une sphère, comme placée au-dessus de tous, assez à l’image de la religion, qui permet de stimuler notre sensibilité et notre intellect, tout en nous défaisant des chaînes de la routine et de l’évidence. C’est ce qui a été tenu pour essentiel lors de l’humanisme naissant à Florence, et ailleurs en Europe au XVe siècle, qui aura célébré le canon d’une beauté idéale, quasi divine, conformément à l’esprit platonicien prévalant alors. Et c’est ce qui a pris des formes plus prosaïques et diverses au moment de la première modernité, vers la fin du XVIIIe siècle, qui aura vu l’ouverture de musées, bibliothèques, théâtres et salles de concert. Les Lumières représentant, avant tout, un processus, Enlightment, dit-on en anglais (au sens d’éclairer, d’éveiller), soit le projet d’œuvrer au plus grand (...).
Pour lire la suite : www.lascene.com